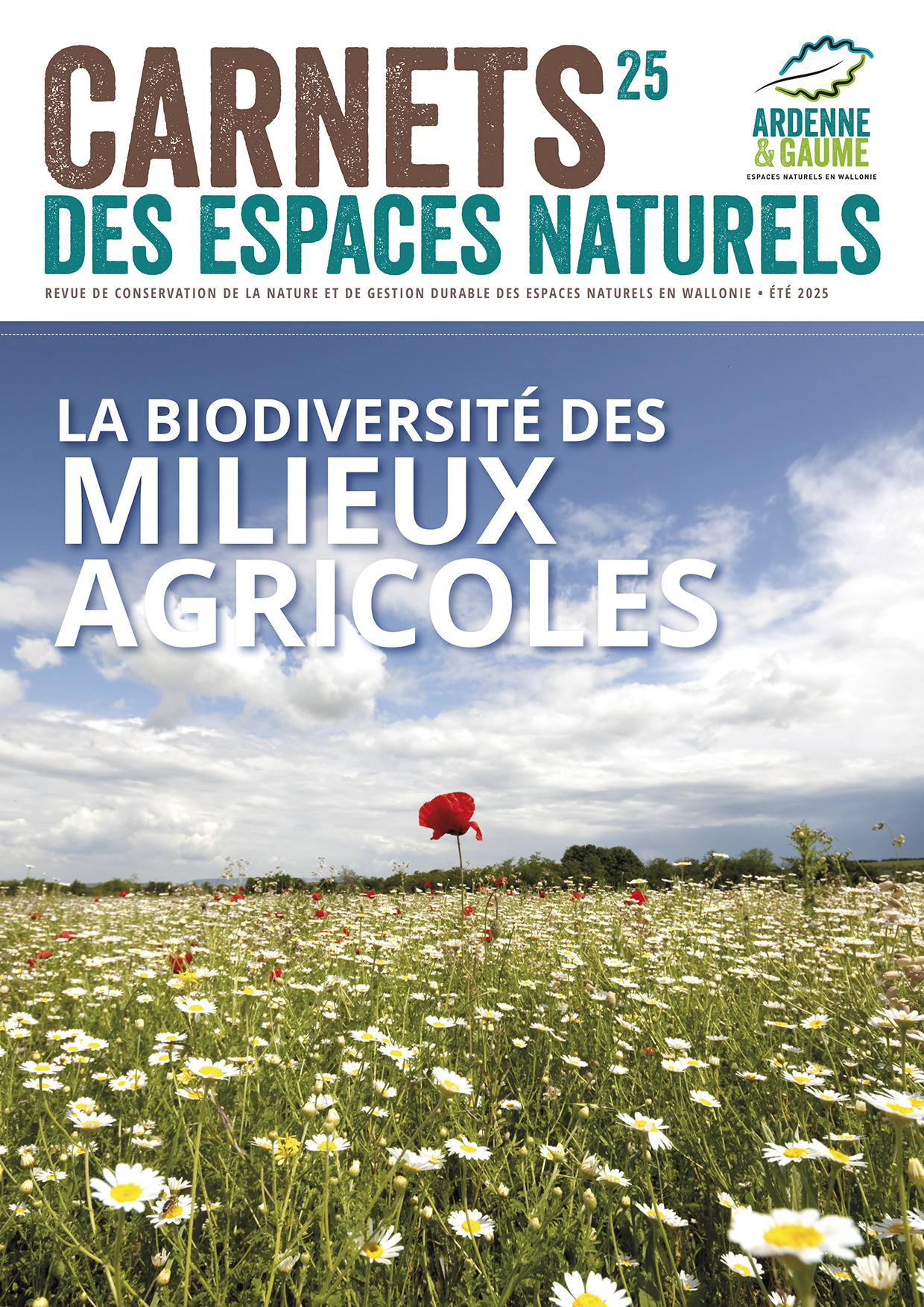
Dans les années 1930, au coeur des Grandes Plaines américaines, la terre s’est mise à parler une langue sèche et râpeuse. Le vent, jadis compagnon des moissons, est devenu un fauve. Ainsi apparut le « Dust Bowl », cet immense linceul de poussière qui recouvrit champs, villes et espoirs, pendant près d’une décennie.
Ce désastre n’est pas né d’un cataclysme soudain, mais d’une longue erreur. Poussés par le rêve d’abondance, les hommes avaient retourné les prairies sauvages pour y planter du blé à perte de vue. La nature, violentée, mais silencieuse, semblait se plier à leur volonté. Jusqu’au jour où la pluie cessa de tomber.
Entre 1934 et 1936, les sécheresses sévères et les mauvaises pratiques agricoles firent des terres un sable libre, arraché par les vents. Les tempêtes de poussière noircissaient le ciel, étouffaient les bêtes, infiltraient chaque interstice des maisons. Les paysages prenaient des allures d’apocalypse. On allumait les lampes en plein jour, non pour chasser la nuit, mais pour percer l’épaisseur brunâtre suspendue dans l’air.
Face à l’ampleur du désastre, le gouvernement de Roosevelt initia des réformes profondes : création de la « Soil Conservation Service (SCS) » en 1935 afin de promouvoir des techniques agricoles durables pour lutter contre l’érosion des sols ; mise en place du « Shelterbelt Project » (1934-1942), projet massif de plantation d’arbres sur plus de 1 600 km (du Canada au Texas) pour créer des brise-vent et réduire l’érosion. Plus de 200 millions d’arbres sont plantés, notamment grâce au « Civilian Conservation Corps (CCC) » : un programme du New Deal fournissant des emplois dans la conservation de la nature. Une sorte de « Yes we plant » gonflé à la sauce Marvel. On peut encore citer l’« Agricultural Adjustment Act (AAA) », une loi visant à réduire la surproduction agricole, à stabiliser les prix et à acheter des terres marginales pour les retirer de la production (l’« ancêtre » de notre projet 97 du Plan de Relance de la Wallonie).
Tiens, tiens, tout cela nous semble si lointain, voire suranné et en même temps familier. En effet, l’Europe n’a pas été exempte de reproches dans sa conception de l’agriculture et cela dès la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Il fallait nourrir tout le monde et vite. Sans trop réfléchir nous nous sommes vautrés dans ce qui nous semblait être la modernité, un productivisme bien mal nommé « révolution verte » pour en arriver à un constat cinglant : nous avions, nous aussi notre « Dust Bowl » dont les effets se font encore et toujours sentir en 2025. Pesticides, PFAS, algues vertes, effondrement des populations d’insectes, érosion des terres, stérilisation des sols, émission de gaz à effet de serre et disparition des zones humides et des espaces sauvages.
Tous ces effets malheureux de l’industrialisation de l’agriculture devaient donc, eux aussi être pris en compte et des mesures fortes et généralisées appliquées pour retrouver un équilibre durable. Les mesures agroenvironnementales (MAE) ont donc été introduites dans ce sens en 1992 dans le cadre de la réforme de la Politique Agricole Commune (PAC). En Wallonie, le premier programme agroenvironnemental est publié au moniteur belge en 1995. Des mesures phares du programme actuel y sont déjà proposées : le maintien des mares, l’exploitation tardive des prairies, la mise en place de tournières enherbées, ou encore le soutien aux races locales menacées. On peut dire qu’au début ce ne fut pas un raz-de-marée d’enthousiasme. Les MAE (devenues MAEC avec C pour climat en 2014) ont connu des hauts et des bas au gré des décisions politiques et de l’état des finances européennes, mais le principe s’améliore pourtant, notamment en intégrant plus sensiblement la notion de maillage, et semble (un peu) mieux tenir compte des avancées scientifiques et des urgences environnementales.
Il ne faut, hélas pas crier victoire trop vite, car les peurs et les vieux réflexes ne sont jamais bien loin et ce ne sont pas les assauts furieux des droites populistes et conservatrices pour démolir les mesures pourtant nécessaires du « Green Deal » européen qui nous rassureront sur ce point. Le vote de la sinistre loi « Duplomb » en France ou le déclassement du loup comme espèce « strictement protégée » à « espèce protégée » doivent sonner comme des alertes pour nous rappeler que l’humain apprend difficilement de ses erreurs et qu’un nouveau « Dust Bowl » est toujours possible, voire probable si on ne se ressaisit pas.
Cet article est l’édito des Carnets des Espaces Naturels N°25.
Crédit photo : Tempête de poussière à Rolla, Kansas, 6 mai 1935 © Everett Collection




